Cristina García Rodero, España oculta, Lunwerg, 1989.
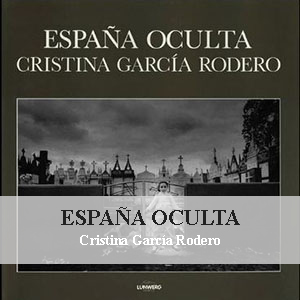 On raconte que Puertollano es el pueblo de las dos mentiras. Puertollano n’est ni un port ni une plaine. Pourtant, des ports on fout le camp. C’est de là que l’on part, que l’on quitte terre et famille, souvenirs, désillusions, joies et peines secrètes. Alors Puertollano n’est pas si mal nommée parce qu’après tout, les villes de province sont toutes des ports de partance d’où l’on fuit la plaine d’une vie. Quand Cristina García Rodero — elle est née dans ce bourg en 1949 — a eu 20 ans ou moins ou à peine plus, Puertollano n’avait pas d’aube en vue. On fuit la nuit. Les usines d’extraction de charbon fermaient, les mines noires des forçats aux yeux incandescents se voilaient d’un crêpe de deuil sans fin et s’échapper c’était vivre, c’était prendre un bateau et vogue la galère qui serait moins galère que les rues qui agonisent pleines d’un vent silencieux comme des enfants orphelins. Puertollano fout le bourdon, les immeubles récents, abjects et fiers témoins des nouvelles industries, ne donnent pas le change, au contraire, la ville est froide comme un cadavre et raide aussi.
On raconte que Puertollano es el pueblo de las dos mentiras. Puertollano n’est ni un port ni une plaine. Pourtant, des ports on fout le camp. C’est de là que l’on part, que l’on quitte terre et famille, souvenirs, désillusions, joies et peines secrètes. Alors Puertollano n’est pas si mal nommée parce qu’après tout, les villes de province sont toutes des ports de partance d’où l’on fuit la plaine d’une vie. Quand Cristina García Rodero — elle est née dans ce bourg en 1949 — a eu 20 ans ou moins ou à peine plus, Puertollano n’avait pas d’aube en vue. On fuit la nuit. Les usines d’extraction de charbon fermaient, les mines noires des forçats aux yeux incandescents se voilaient d’un crêpe de deuil sans fin et s’échapper c’était vivre, c’était prendre un bateau et vogue la galère qui serait moins galère que les rues qui agonisent pleines d’un vent silencieux comme des enfants orphelins. Puertollano fout le bourdon, les immeubles récents, abjects et fiers témoins des nouvelles industries, ne donnent pas le change, au contraire, la ville est froide comme un cadavre et raide aussi.
Quand elle a eu 20 ans ou moins ou à peine plus, Cristina García Rodero a pris un bateau grand comme une boîte à souvenirs, un frêle esquif auquel on s’attache facilement et qui la conduirait, elle devait le savoir, sur l’océan inconnu de son propre pays. Elle n’a pas photographié son temps ou ses contemporains, les rues de Madrid ou les putes au bord des routes catalanes ou andalouses. Elle a pris la joie où elle se trouvait, un peu partout, un peu tous les jours dans cette Espagne des fêtes qui hurlent, qui flambent, qui tuent, qui boivent, qui prient et qui rient pour finir. Et chose extraordinaire, comme si les lieux qui nous voyaient grandir laissaient en nous un maigre soupçon d’eux-mêmes, elle a réussi à faire de ses photographies des mensonges pour lesquels le mot sublime serait, au mieux, une insulte. Les mensonges de García Rodero ne sont d’aucune école : expressionnistes, réalistes, surréalistes ; ils sont des coups de poing douillets, des cris symphoniques, des ports dans une plaine continentale.
Il y a cette petite fille qui saute devant la porte d’un cimetière. Elle est vêtue d’un blanc qui aveugle comme une irradiation. Les morts la poussent vers notre œil, la suspension crée le trouble. La petite fille inquiète, fantomatique et goyesque. Et il y a cette autre qui dort sur des cotrets de blé. Ses parents — on imagine qu’ils sont ses parents — battent le grain derrière elle qui n’entend pas, qui dort comme dorment les gosses. Millet en noir et blanc.
Les clichés de Cristina García Rodero présents dans ce livre « España oculta » sont les mensonges de l’art. Du réel figé dans les nuances de gris, les blancs tranchants et les noirs ténébreux accouchent d’autres mondes qui hantent nos pensées ; des mensonges en forme de vérités intimes… des ports dans la plaine. — Laurent Larrieu
« España oculta » de Cristina García Rodero chez Magnum Photos
Cristina García Rodero. España oculta, Lunwerg, 1989.
