Épisode IV : Ganadería Sobral (encaste Cebada Gago et Marques de Domecq) / Herdade Barbas de Lebre, Baleizão (Beja).
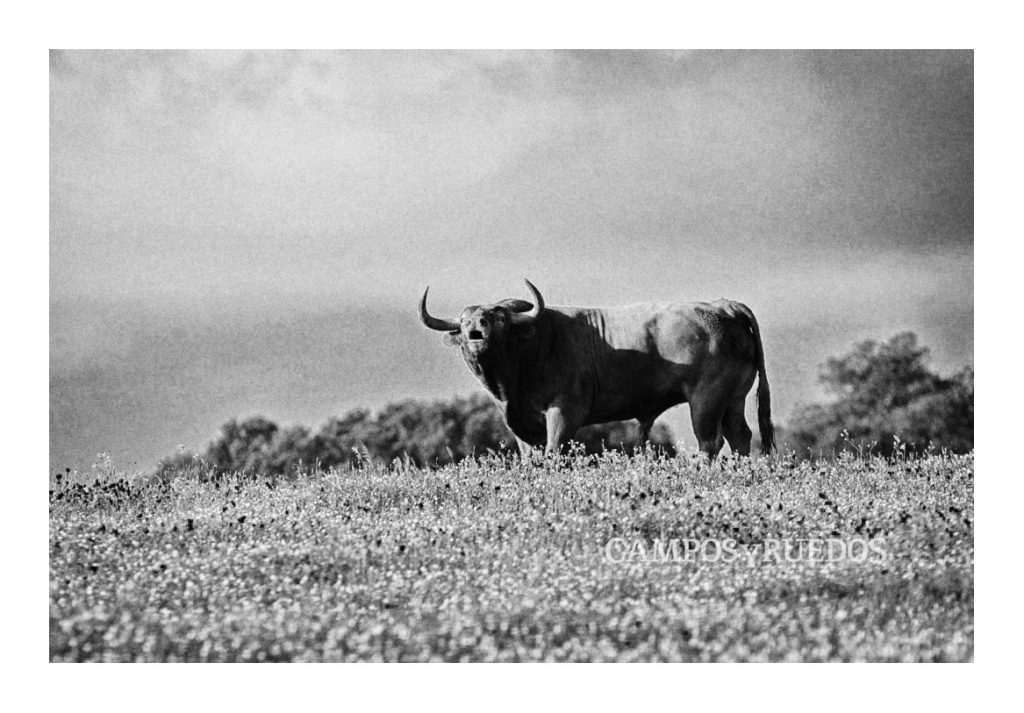 Pour saisir le comment de cette récente ganadería portant elle aussi le patronyme de Sobral — Passanha Sobral au Portugal —, il est nécessaire de traverser la frontière et d’emprunter la ruta de la plata qui plonge au sud vers Séville puis vers les terres sèches et poussiéreuses du campo de Jerez de la Frontera. Il faut se caler dans les pas qui menèrent la famille Passanha Sobral vers l’exil après la Révolution des oeillets de 1974. Car c’est dans le sud de l’Espagne que les enfants de Maria Passanha trouvèrent refuge après que leurs hommes les avaient dépouillés de leurs richesses et de leurs hectares par milliers. En regardant palabrer José Antonio Sobral (fils de Manuel Francisco et petit-fils de Maria Passanha) et Manoel comme de vieux amis auraient coutume de la faire, je me suis demandé si les choses allaient toujours aussi sereinement que l’impression qu’elles en donnaient de prime abord. Le temps a passé depuis le retour des Passanha Sobral sur une partie de leurs terres (1985) — ce temps qui effrite la mémoire comme on décroche du mur des pans entiers d’une vieille tapisserie — mais la réalité ne peut pas être aussi simple que cette apparente mer d’huile des relations sociales. Je me surpris à imaginer qu’au loin de redoutables tempêtes aspiraient l’extrémité de vagues invisibles depuis la côte, que grondaient de puissants orages qui déchiraient un ciel peint par Le Greco comme on se jouerait, rageur, d’une feuille de papier. En les observant, ma mémoire déjà virevoltante s’est mise à n’en faire qu’à sa tête, revêche aux ordres vaniteux, et, si les toros étaient à deux pas, si leur présence ici justifiait la nôtre en ce matin de ciel bleu balbutiant, c’est vers mon grand-père que je tournais la tête, le dévisageant d’en bas parce que j’avais 10 ans, lui, légèrement voûté, le torse fort m’ayant toujours semblé trop lourd pour de si fines jambes, et j’entendais à nouveau sa voix où roulaient les caillasses d’une vie de tabac : » Salut ! Ça va ? Oh, ils annoncent mieux demain. On verra. Allez, adieu, à demain « . Et sans que ce corps disjoint ne se meuve d’un poil, sans que le son de sa voix ne s’émeuve d’un rien, sans que ses yeux fixés sur le palmier au centre de la cour ne tressaillent d’un cil, il ajouta pour lui seul, comme une confidence sur laquelle on ne reviendra pas parce que la dire une fois suffit et ça fait mal : » c’était un collabo lui ! »
Pour saisir le comment de cette récente ganadería portant elle aussi le patronyme de Sobral — Passanha Sobral au Portugal —, il est nécessaire de traverser la frontière et d’emprunter la ruta de la plata qui plonge au sud vers Séville puis vers les terres sèches et poussiéreuses du campo de Jerez de la Frontera. Il faut se caler dans les pas qui menèrent la famille Passanha Sobral vers l’exil après la Révolution des oeillets de 1974. Car c’est dans le sud de l’Espagne que les enfants de Maria Passanha trouvèrent refuge après que leurs hommes les avaient dépouillés de leurs richesses et de leurs hectares par milliers. En regardant palabrer José Antonio Sobral (fils de Manuel Francisco et petit-fils de Maria Passanha) et Manoel comme de vieux amis auraient coutume de la faire, je me suis demandé si les choses allaient toujours aussi sereinement que l’impression qu’elles en donnaient de prime abord. Le temps a passé depuis le retour des Passanha Sobral sur une partie de leurs terres (1985) — ce temps qui effrite la mémoire comme on décroche du mur des pans entiers d’une vieille tapisserie — mais la réalité ne peut pas être aussi simple que cette apparente mer d’huile des relations sociales. Je me surpris à imaginer qu’au loin de redoutables tempêtes aspiraient l’extrémité de vagues invisibles depuis la côte, que grondaient de puissants orages qui déchiraient un ciel peint par Le Greco comme on se jouerait, rageur, d’une feuille de papier. En les observant, ma mémoire déjà virevoltante s’est mise à n’en faire qu’à sa tête, revêche aux ordres vaniteux, et, si les toros étaient à deux pas, si leur présence ici justifiait la nôtre en ce matin de ciel bleu balbutiant, c’est vers mon grand-père que je tournais la tête, le dévisageant d’en bas parce que j’avais 10 ans, lui, légèrement voûté, le torse fort m’ayant toujours semblé trop lourd pour de si fines jambes, et j’entendais à nouveau sa voix où roulaient les caillasses d’une vie de tabac : » Salut ! Ça va ? Oh, ils annoncent mieux demain. On verra. Allez, adieu, à demain « . Et sans que ce corps disjoint ne se meuve d’un poil, sans que le son de sa voix ne s’émeuve d’un rien, sans que ses yeux fixés sur le palmier au centre de la cour ne tressaillent d’un cil, il ajouta pour lui seul, comme une confidence sur laquelle on ne reviendra pas parce que la dire une fois suffit et ça fait mal : » c’était un collabo lui ! »
À 10 ans un collabo n’a rien d’une évidence et sans en comprendre le sens disons historique, la mémoire familiale m’en offrait pourtant une traduction des plus limpides : le collabo, c’était un méchant du temps de la guerre de papy. Cette guerre qu’il resuçait presqu’autant que ses bâtons de réglisse qui étaient sensés le faire stopper les cigarillos et avec laquelle il avait été incapable de rompre parce qu’elle fut son âge tendre tout autant que la gifle de laquelle il s’éveilla adulte. Des années plus tard, il était mort assis sur une chaise, comme ça, sans en faire trop et n’avait pas tout raconté. Au détour d’une de ces visites que l’on fait à sa grand-mère vieillissante et veuve et heureuse de vous voir, vous le jeune con trop pressé parce que la vie est courte, déjà, même à vingt ans, elle était revenue sur ces années-là et sur celles qui avaient suivies. » Tu sais, un jour des gendarmes sont venus le voir. C’était 10 ans après la fin de la guerre. Oui… c’est ça, une dizaine d’années après « .
Ils étaient arrivés un matin, avaient gravi l’escalier qui conduisait à la porte d’entrée de la grande salle à manger — un laurier rose gênait souvent le passage ou du moins fleurissait pas trop loin — ils avaient frappé, la mine confuse, comme emmerdés. » Il est sorti « . Ils venaient lui annoncer la nouvelle. Rien ne les y obligeait mais ils avaient tenu à le lui dire de vive voix. » Il est sorti. Alors déconne pas. Il a payé son dû à la société et à la justice. Il a fait ses 10 ans de tôle. Déconne pas G. Va pas essayer de te faire vengeance « .
Quand j’ai lu La nuit, le jour et toutes les autres nuits*, des années plus tard, j’ai pris conscience qu’il avait été de cette partie sans que je puisse lui en vouloir. Et puis de quel droit lui en aurais-je voulu ? Et de quoi ? Ça avait été sa vie à lui, ses choix, et, bien pesé, je ne les trouvais pas honteux mais je restais intellectuellement hébété au sortir de ma confrontation avec cette période de l’histoire. Hébété mais surtout frustré au dernier degré de me rendre compte qu’il me serait à jamais impossible de percevoir ne serait-ce qu’en surface ce qu’avait été la réalité profonde, humaine et même charnelle de cette époque qui ne se résumait pas à l’opposition simpliste entre les collabos et les résistants. Il en allait ainsi de toute l’histoire, c’était certain, il fallait l’accepter. Accepter que la vérité des êtres, celle de leurs pensées obscures ou de leurs désirs réels ne s’atteint jamais. Prétentieux, on croit s’en approcher mais tout est faux. On ne sait rien du passé ! Et puis la justice n’est pas la vengeance. La nécessité de la première n’interdit pas le désir viscéral de voir la seconde assouvie. L’état de droit apaise la tempête qui aspire les vagues dans la nuit du Greco. Ça ne va plus loin car la tempête est une bête qui ouvre encore la gueule, un oeil toujours ouvert, prêt à l’attaque. C’est ça que je me disais en me regardant à 10 ans observer par en bas mon grand-père traiter son voisin de toute une vie de collabo. C’est ça que je pensais en scrutant le visage encore jeune de José Antonio Sobral. Comment ont-ils fait eux ? Il a fallu redire bonjour, refaire des sourires. Il a fallu reparler du temps, de la pluie à venir et des vieux qui meurent au village. Il a fallu de nouveau regarder dans les yeux celui qui vous avait insulté, redire un mot à ce patron riche à millions que l’on détestait et à qui l’on avait été heureux et fier et vengé, oui vengé, de prendre les terres. Il a fallu ravaler les ressentiments, grignoter sa dignité aux bordures, se voûter un peu plus, tourner le regard aussi. Il a fallu se dire à soi-même, sans l’aide d’un gendarme : » déconne pas. Il a fait ses 10 ans « .
- Audiard (Michel) – La nuit, le jour et toutes les autres nuits – Évocation magnifique et dramatique des heures de l’épuration en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
à suivre…
